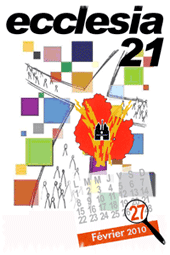Lundi 2 novembre, jour des défunts. A la messe ce soir-là, une assistance moins fournie que d'habitude, mais j'y retrouve un certain nombre de paroissiens à la porte desquels la mort a frappé plus souvent qu'à son tour. Il y a là, en particulier, beaucoup de parents qui ont eu la douleur de perdre un enfant. Ce deuil-là ne se fait jamais ; ils viennent donc avec des questions qui n'ont pas reçu de réponse.
Le deuil est un chemin sur lequel on avance sans savoir où il nous mène. On y fait une expérience terrible et fondamentale : nul n'est maître de sa propre vie. Il ne s'agit pas de la vie de celui qui n'est plus, mais de celle de l'endeuillé, tout-à-coup précipité dans une tempête qui peut aller jusqu'à lui faire perdre la maîtrise du fragile esquif dans lequel il se meut. La mort est un formidable coup d'accélérateur dans la vie de ceux qui restent, une embardée qui nous fait comprendre que nous ne sommes pas seuls aux commandes.
Là-dessus, l'Eglise est étonnamment discrète. Elle pourrait en profiter pour asséner des certitudes, dresser la fresque magnifique de la béatitude des élus et le tableau terrifiant du jugement ; elle aime mieux écouter, accompagner, pleurer avec. Aux dogmes, elle préfère les conseils ; plutôt que de parler, elle agit.
Devant la mort, il faut faire. A chaque fois que je célèbre des funérailles, je pense au livre d'Henri Laborit,
Eloge de la fuite, dont Alain Resnais avait tiré un film remarquable : ce qui est épouvantable dans l'inconnu, c'est de se sentir impuissant. C'est là que les chrétiens (je précise : les catholiques) ont quelque chose à dire. En quelques mots, ce soir du 2 novembre, je rappelle toujours ce que le christianisme a changé dans l'approche de la mort : les nécropoles sont devenues des cimetières (c'est-à-dire des dortoirs), les défunts ont été mis en terre pour évoquer le grain de blé de l'Evangile et la plante de Paul, allongés sur le dos comme pour un sommeil. La célébration a lieu en présence du corps, ce qui signifie la foi en la résurrection de la chair. Quant aux morts, ils continuent à faire partie de cette communion des saints qu'est l'Eglise, et c'est la raison pour laquelle nous continuons à prier pour eux. La liturgie de l'Eglise, qui se poursuit jusqu'à l'inhumation, agit comme un message subliminal, plus fort que tous les discours que l'on peut tenir.
Plus que des repères, donc, la célébration des obsèques chrétiennes est une invitation à entrer, avec tout ce que nous sommes et pas seulement nos pensées, dans l'univers de l'espérance. Et c'est bien là, aujourd'hui, que les questions se posent : car les repères disparaissent, et sont remplacés par nos représentations subjectives et contradictoires, avec l'encouragement de sociétés de pompes funèbres qui n'ont qu'un souci, satisfaire leurs clients. Allons au supposé moins cher (la crémation), au plus rapide (la célébration dans une
funeral home), au moins traumatisant (on laissera les enfants à la maison pour ne pas leur faire peur). Quant à la prière pour les défunts, à quoi bon puisque de toute façon ils sont morts et on ne peut plus rien pour eux. La mort est mal partie.
 Ecolos-cathos : la formule est bien trouvée, elle nous vient de Guillaume de Prémare et de son blog qui porte le souci de faire connaître la face cachée de l'Eglise catholique, c'est-à-dire tout ce qu'elle fait de positif et dont on ne parle pas.
Ecolos-cathos : la formule est bien trouvée, elle nous vient de Guillaume de Prémare et de son blog qui porte le souci de faire connaître la face cachée de l'Eglise catholique, c'est-à-dire tout ce qu'elle fait de positif et dont on ne parle pas.